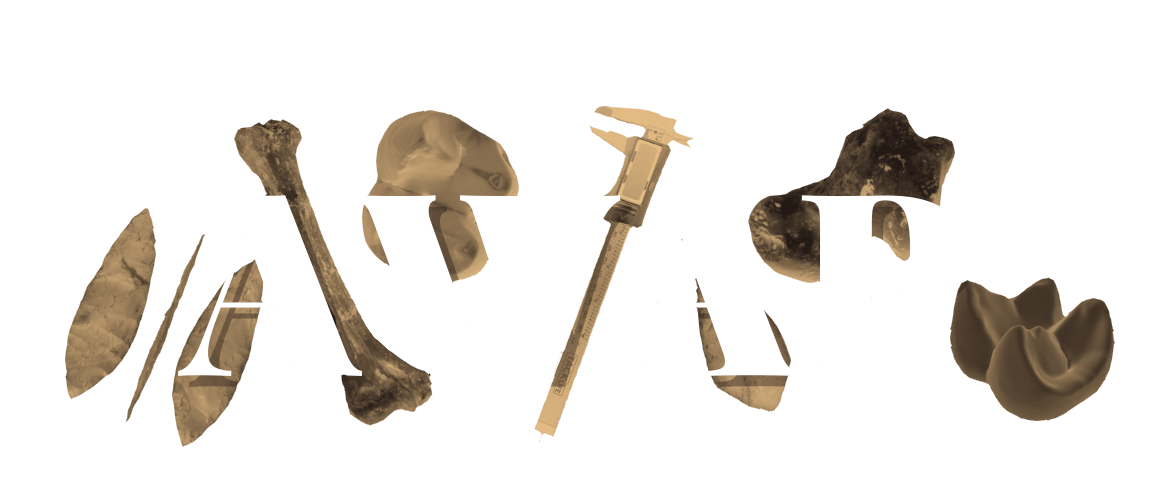L’Ecart Entre Les Sexes
Why We Need Change
La création des initiatives VCWAP et AWAP a été motivée par une réalité persistante et bien documentée : bien que les femmes atteignent souvent des niveaux d’éducation plus élevés que les hommes, elles restent sous-représentées dans la communauté scientifique, en particulier dans les rôles de direction et dans les domaines STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques). À l’échelle mondiale, les femmes représentaient seulement 31,7 % des chercheurs en 2021, une légère progression par rapport à 30 % en 2017 (UNESCO). Cette représentation varie considérablement selon les régions, allant de 49,6 % en Asie centrale à seulement 25,9 % en Asie du Sud et de l’Ouest.
Les disparités de genre dans le milieu académique sont particulièrement visibles dans les postes seniors, où les femmes sont moins susceptibles d’occuper des rôles tels que professeur ou directeur de recherche (Lerman et al., 2022 ; Ross et al., 2022). Elles publient également moins d’articles scientifiques, déposent moins de brevets, et sont sous-représentées en tant que rapporteures et éditrices dans les revues scientifiques. Ces écarts sont aggravés par des problèmes systémiques tels que le leaky pipeline, où les femmes quittent plus souvent les carrières académiques, ainsi que par les biais dans l’attribution de la titularisation, des financements et de la reconnaissance.
Les prix prestigieux comme les prix Nobel illustrent également cette disparité. Depuis leur création en 1901, seulement 25 femmes ont été récompensées dans les catégories scientifiques, soit à peine 5 % des lauréats (Lunneman et al., 2019). Les biais persistants dans l’attribution des crédits favorisent souvent les hommes scientifiques seniors, comme en témoigne le cas de Rosalind Franklin, dont les contributions majeures à la découverte de la structure de l’ADN n’ont pas été reconnues. Plus récemment, des controverses ont entouré Rosalind Lee, dont les contributions cruciales à la découverte des microARN ont été négligées lorsque ses collègues masculins ont reçu le prix Nobel de physiologie ou médecine. Selon des études, il existe une probabilité de 96 % que les résultats des prix Nobel soient influencés par des biais de genre, aggravés par le privilège socio-économique des lauréats.
La pandémie de Covid-19 a intensifié ces défis, affectant de manière disproportionnée les chercheuses en réduisant leur productivité et en élargissant les inégalités préexistantes (Minello, 2020 ; Viglione, 2020 ; Squazzoni et al., 2021). Les études ont également documenté le rôle des barrières culturelles et structurelles dans le découragement des jeunes filles à poursuivre des carrières dans les STEM. Ces barrières incluent des stéréotypes profondément ancrés, des environnements de travail masculins, une exposition limitée aux matières STEM dans l’éducation précoce, et un manque de modèles.
Malgré ces défis, des progrès sont possibles. La collecte de données par l’UNESCO et d’autres organisations souligne l’importance de politiques basées sur des preuves pour combattre les inégalités de genre. Des pratiques inclusives, telles que la refonte des environnements de travail, le mentorat et la promotion de la visibilité des femmes dans les sciences, sont essentielles pour développer des talents diversifiés.
Dans les domaines de l’archéologie et de la paléontologie, les inégalités de genre sont tout aussi omniprésentes. Les femmes ont apporté des contributions significatives à ces disciplines, mais leurs réalisations ont souvent été minimisées ou ignorées. Les stéréotypes de genre, l’autocensure et l’invisibilisation ou la minimisation des contributions des femmes scientifiques à la recherche (l’effet Matilda) continuent de compromettre l’équité académique.
Les initiatives VCWAP et AWAP ont été créées pour aborder directement ces problèmes. Au-delà de la promotion du travail des archéologues et paléontologues cis et trans, en particulier celles sans poste permanent, ces initiatives visent à créer des réseaux de soutien mutuel et à inspirer les futures générations. En mettant en lumière les réalisations des femmes scientifiques et en plaidant pour des changements structurels dans le milieu académique, nous contribuons à construire une communauté de recherche qui valorise et reflète l’équité de genre.
Réduire les écarts de genre dans la recherche et le milieu académique n’est pas seulement une question de justice, mais une étape cruciale pour libérer le plein potentiel du vivier mondial de talents. En luttant contre les biais, en redessinant des environnements inclusifs et en mettant en œuvre des politiques intersectionnelles, nous pouvons créer une communauté scientifique plus équitable qui reflète et sert mieux la diversité de notre monde.
Sources
Cheryan et al., 2024: https://doi.org/10.1038/s44159-024-00380-3
Lerman et al., 2022: https://doi.org/10.1073/pnas.2206070119
Lunneman et al., 2019: https://doi.org/10.1057/s41599-019-0256-3
Minello, 2020: https://doi.org/10.1038/d41586-020-01135-9
Oza, 2024: https://www.statnews.com/2024/10/11/nobel-prizes-2024-gender-bias-science/
Palincaş and Martins, 2024: https://doi.org/10.1007/978-3-031-52155-3_1
Ross et al., 2022: https://doi.org/10.1038/s41586-022-04966-w
Squazzoni et al., 2021: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257919
UNESCO Report (February 2024): https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000388805
Viglione, 2020: https://doi.org/10.1038/d41586-020-01294-9